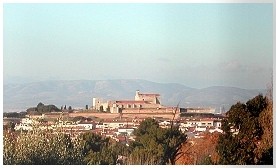Les remparts de Perpignan
Perpignan est au coeur de la petite plaine alluviale du Roussillon qui naît au pied du Canigou, dernier bastion des Pyrénées orientales, pour mourir aussitôt dans le lâche réseau des étangs sablonneux de la côte méditerranéenne.

Le premier texte mentionnant Perpignan date de 927. C'est à cette époque un simple village. Cependant, signe de son rapide développement, les comtes du Roussillon y établissent leur résidence à la fin du Xe s. Lorsqu'en 1172 le roi d'Aragon acquiert le titre de comte du Roussillon, Perpignan accepte volontiers la suzeraineté aragonaise. À cette époque elle a déjà toutes les caractéristiques d'une ville médiévale, bientôt dotée d'une charte communale (1197). À la fin XIIIe s. Jacques le Conquérant partage ses possessions en deux royaumes et Perpignan devient dès lors la capitale continentale du royaume de Majorque. Puis en 1344 après maintes vicissitudes la vila fidelissima (1) retourne à l'Aragon. Enfin, à partir de la fin du XVe s., elle sera tour à tour place forte des rois d'Espagne ou des rois de France.
Aujourd'hui, c'est une ville d'importance moyenne (115000 habitants). Sur un plan économique, elle tire sa richesse de l'agriculture : vins, fruits et légumes. Depuis l'arrivée du chemin de fer au milieu du XIXe siècle, la ville a développé un important marché agricole. Si elle bénéficie des retombées économiques du tourisme, c'est grâce à l'attrait indéniable du Roussillon qui, situé entre mer et montagne, séduit le visiteur par sa diversité. Certes Perpignan possède un patrimoine historique intéressant : des édifices civils, des églises, des couvents... (2) mais c'est une ville qui a perdu beaucoup de son caractère avec la démolition de ses remparts.
Les fortifications de la place forte étaient si complètes qu'elles auraient amplement suffi à fournir des exemples à n'importe quel manuel qui aurait eu pour objectif de faire comprendre l'architecture militaire et son évolution dans le temps (3). Leur originalité aurait pu apporter à la ville sur le plan touristique des ressources appréciables. Hélas, la rapide et spectaculaire destruction des remparts nord en 1904-1906, puis celle des remparts sud en 1930 ont définitivement compromis cet espoir.
Au début du XIVe siècle, Perpinyà, la capitale du royaume de Majorque, est à son apogée. C'est une ville médiévale dynamique. Ville d'artisans et de commerçants, la prospérité vient surtout de l'industrie du drap, de la laine et du cuir, et du grand commerce maritime.
La ville se dote d'une vaste enceinte, succession de courtines flanquées de tours rondes, qui englobe le puig Sant Jaume et le puig del Rey sur lequel Jacques II de Majorque fit construire son palais. Cependant, dès la fin du XIVe siècle, la "diminution des échanges et le marasme financier, [...] les terribles effets de la peste noire de 1348 qui produisirent une brutale diminution de la population" (MD), sont parmi les principales causes de la décadence de Perpinyà et plus généralement de tout le midi méditerranéen. Ce déclin, qu'on peut mesurer dans l'arrêt brutal du chantier de la collégiale Saint Jean-Baptiste, n'affecte cependant pas les travaux concernant les remparts : en 1368 sous Pierre IV d'Aragon on construit la première porte Notre-Dame flanquée de ses deux tours de briques qui deviendra plus tard le Castillet.
À partir de la fin du XVe s., Perpiñán ou Perpignan devient l'enjeu des luttes franco-espagnoles. Il s'entoure d'un complexe de fortifications sans cesse amélioré. Les boulevards se multiplient, apparaissent les premiers bastions et les premières demi-lunes qui effacent peu à peu les murailles et les tours majorquines.
Que ce soit par Louis XI ou plus tard par les rois d'Espagne Charles Quint et Philippe II, Perpignan est fortifié tant contre l'ennemi extérieur que pour réprimer les fréquents soulèvements de la ville catalane contre l'État. Au sud, se crée une vaste citadelle autour du palais des rois de Majorque au détriment de la population qui voit son espace urbain rétréci. C'est le Castell Major (grand château) qui répond au nord au Castillet (petit château) l'ancienne porte aragonaise transformée en forteresse.
Cependant, malgré cela, la population perpignanaise comprend la nécessité de défendre la ville et participe à l'amélioration de l'enceinte (7) : la construction du premier bastion Saint Jean (1597) et du bastion des Bourgeois (1624-1630) à l'emplacement de l'actuelle place Arago, est ordonnée par les Consuls de la ville à l'instigation des Perpignanais eux-mêmes.
Après le traité des Pyrénées (1659), les travaux les plus marquants sont réalisés sous Louis XIV par Vauban qui crée la Ville Neuve et reprend tous les dehors. Des travaux considérables seront réalisés encore sous Napoléon III, quelques années à peine avant le démantèlement de la place forte.
En 1904 débute la rapide et spectaculaire destruction des remparts nord. Entre le viaduc de la porte de Canet et celui de la porte Saint Martin, les démolisseurs ouvrent de larges brèches simultanément en plusieurs points. Le bastion du Castillet, pourtant classé monument historique n'est pas épargné. S'attaque-t-on à de vieilles murailles menaçant ruines ? Ce n'est pas le cas : on peut dire qu'on est passé directement de la construction à la destruction. Durant tout le XIXe s., les travaux d'entretien et de modernisation s'étaient succédés. De 1840 à 1870, de nouveaux ouvrages (porte Magenta, porte Impériale, ponts éclusés) tout en agrandissant et consolidant la place forte, avaient permis de refaçonner le centre de Perpignan.
Les destructions continuent à partir de 1930 par les remparts sud occupés surtout par la grande citadelle. Celle-ci est épargnée mais elle perd tous ses dehors et se retrouve au 2/3 enterrée du côté de la campagne du fait du comblement des fossés. Jusqu'à la fin du XXe siècle les quelques lambeaux de fortifications encore debout sont régulièrement avilis par des aménagement urbains réalisés dans une méconnaissance étonnante de la valeur historique de ce patrimoine. En 1974 la caserne Saint-Martin du XVIIe s. est rasée.
Il serait souhaitable que la destruction des fortifications qui commença avec le XXe siècle puisse être aujourd'hui, à l'orée du XXIe, considérée comme une époque révolue. Pourtant en 2003 encore les maladresses ne sont pas évitées : le long de la rue Rabelais, on détruit la porte et plus de la moitié de la clôture d'un magasin à poudre du XVIIe s. qui était parvenu jusqu'à nous presque intact.
Seule exception au continuel massacre, l'aménagement du bastion Saint-Jacques en jardin botanique d'essences méditerranéennes. Ce petit jardin si peu connu des perpignanais est une réussite qui rappelle qu'en d'autres temps, les bastions de France et des Capucins avaient été coiffés d'un élégant et vaste jardin de plantes et arbustes sous l'impulsion du comte de Mailly... À cette époque, les améliorations apportées à la ville (élargissement des rues, agrandissement et création d'égouts) allaient de pair avec l'aménagement des remparts, mais c'était au siècle des lumières !...
 Les prétextes de la démolition
Les prétextes de la démolition
"L'anéantissement en à peine deux ans des témoignages de plus de six siècles d'histoire s'est fait pratiquement sans oppositions" (ADRa). Dès 1885 la population soutenue par le conseil municipal, adresse une pétition aux autorités militaires demandant d'étudier un projet d'agrandissement de la ville : remplacer l'enceinte fortifiée par des forts détachés est l'une des solutions proposées (VW). C'est à partir de cette même année que s'engagent des discussions difficiles entre les élus et le Ministre de la Guerrre qui vont durer 20 ans. Elles aboutiront au déclassement de la place et au démantèlement des fortifications.
Il est dommage que parmi nos édiles aucun n'ait pu sentir qu'il n'y avait pas lieu de faire l'amalgame entre déclassement et démantèlement. Le déclassement était absolument nécessaire. Sans lui, à cause des zones de servitudes militaires, les faubourgs ne pouvaient pas s'urbaniser. Mais la démolition radicale reste une absurdité et à long terme il y avait plus à perdre qu'à gagner à détruire les remparts.
Donc, tandis que se prolongent d'âpres discussions, se constitue, en 1892, le Comité de la Démolition des Remparts. Il est composé de 80 membres. Ce sont des ouvriers, des entrepreneurs, des artisans, des architectes. En fait, pratiquement tous appartiennent à des corps de métiers qui peuvent tirer un profit personnel à la démolition de l'enceinte. Ils ne cachent d'ailleurs pas cet aspect et on peut lire dans un des hebdomadaires que publie le comité : "La démolition s'impose [...] pour assurer, et pour longtemps, le travail à la classe ouvrière".
À côté de ce type d'argument très corporatiste, revient souvent la question de l'hygiène, de l'insalubrité et du manque d'espace dans la vieille ville. Dans un étonnant aveuglement (4), tant le Comité des Remparts que les municipalités de l'époque ont pensé que les problèmes du tissu urbain : étroitesse des rues, manque de places publiques, déficience du réseau d'égout, etc., tout allait être résolu par la démolition des remparts. En fait, les remparts ont été démolis et les problèmes d'insalubrité ont persisté, dans certains quartiers jusqu'à nos jours. Il est amusant de remarquer à ce sujet que des décennies après la démolition des remparts, comme remède à l'habitat insalubre du quartier Saint-Jacques, il avait été envisagé le même type de solution : raser tout le quartier !
Les méthodes actuelles pour lutter contre l'habitat indigne et les quartiers insalubres sont beaucoup plus convaincantes. Ainsi tout récemment, dans le quartier Saint-Mathieu, la démolition d'un pâté de maisons a permis l'aménagement d'une place qui aère réellement le quartier tout en respectant son caractère.
Un autre argument souvent mis en avant par le Comité de la Démolition des Remparts est que l'enceinte était responsable d'une urbanisation éparpillée et que seule la démolition pouvait permettre un accroissement homogène et structuré de la ville. Pourtant, "les fortifications n'ont jamais constitué un obstacle absolu au développement urbain" (Pierre Pinon). Il existe des villes comme Bayonne, ou Lucques en Italie, qui ont su garder tout ou partie de leurs fortifications et se sont développées à partir des faubourgs (8). De plus, fossés, demi-lunes, chemins couverts et glacis s'adaptent parfaitement à la création de plans d'eau, promenades et autres espaces verts dont nos villes ont tant besoin (5). En fait c'est surtout les plus-values foncières induites par la disparitions des fortifications qui ont motivé nos démolisseurs.
Aujourd'hui nous constatons que la ville éclatée en de multiples pôles attractifs représente la norme. Ces pôles peuvent avoir des origines très diverses. Parfois c'est la volonté délibérée d'une société immobilière comme la création par la SIVP de la ville nouvelle du Moulin à Vent. Parfois l'implantation d'un supermarché installé en rase campagne induit l'apparition d'un pôle commercial bancaire et résidentiel de première importance comme c'est le cas route d'Espagne avec le supermarché l'Escale, devenu Auchan.
D'ailleurs, le maire Jean-Paul Alduy, à propos de la la Communauté d'Agglomération, avait mis en avant cette conception de la ville à fonctionnement multipolaire. On adopta alors la dénomination de "ville archipel" et on refusa de "subir une urbanisation en tache d'huile". On lisait dans les brochures de la Mairie qu'il fallait préserver les "coupures vertes"... Nous y voilà. La majestueuse de ces "coupures vertes", celle qu'on a rendue responsable de tous les maux (jusqu'aux épidémies), c'est elle qui serait aujourd'hui le véritable poumon de la vieille ville. C'est cette conception de l'urbanisme qui aurait pu sauver les remparts si elle avait germé alors dans quelque esprit visionnaire. La place forte serait devenue le pôle historique d'une ville multipolaire. Au lieu de cela, l'enceinte fortifiée a été sacrifiée dans l'indifférence générale entre 1904 et 1930 pour précisément favoriser une urbanisation "tache d'huile" décriée de nos jours.
Et, s'il existe encore des partisans de la tache d'huile, on peut constater que, ironie du sort, quelque trente ans avant cet acharnement du Comité de Démolition pour faire disparaître les fortifications, ce sont les remparts eux-mêmes qui sont à l'origine d'une grande chance pour l'urbanisation de Perpignan. En effet, en 1858 le chemin de fer arrive à Perpignan et les contraintes militaires obligent la gare à s'installer en pleine campagne à près d'un kilomètre au delà des murailles à l'ouest de la Ville-Neuve. Ainsi implantée, et reliée à la ville par une large avenue, la gare, qui au début pouvait sembler bien éloignée de la ville, n'a pas gêné l'extension ouest de Perpignan. Grâce aux remparts, un vaste quadrilatère entre la Basse, le chemin de fer, la Têt et la vieille ville pouvait être urbanisé sans contrainte une fois le déclassement des fortifications obtenu (6).
Voilà, après avoir évoqué les remparts et exprimé mon point de vue sur leur démolition, vous pouvez refermer le livre et... bonne promenade !
(1) Titre décerné en 1475 par le roi Jean II d'Aragon après le siège de la ville par les troupes françaises au cours duquel les perpignanais firent preuve d'une résistance acharnée et de loyauté envers leur roi.
(2) En sa qualité de place forte majeure, la plupart des édifices conventuels de Perpignan ont été attribués à l'armée à partir de la Révolution Française. Ils devinrent : arsenal, caserne, hôpital militaire... Prosper Mérimée a dit à propos des Dominicains de Perpignan, ils "sont en ruines. Le Génie Militaire, grand destructeur, y a établi ses magasins [...] nos officiers du Génie s'entendent beaucoup mieux à renverser des forteresses qu'à conserver des monuments". Pourtant je reste persuadé que ces affectations ont permis dans la plupart des cas d'éviter l'anéantissement total de ce patrimoine.
(3) En 1846, Mme Amable Tastu dans son livre "Voyage en France" écrivait en parlant de Perpignan, ville forte du premier ordre : "On prétend que dans le siècle dernier elle servait comme d'école pratique aux ingénieurs qui y venaient étudier l'histoire des progrès de leur art.".
(4) Ce n'est pas sans une certaine pointe d'ironie que je parle d'aveuglement. Le principal acteur de la démolition, Bartissol, affairiste du XIXe s., a fait preuve parfois d'une perspicacité machiavélique pour faire avancer son projet spéculatif.
(5) À ce propos observons sur la photo satellite de Perpignan l'arc de verdure (allée des platanes et squares) qui est parallèle à la muraille médiévale. On constate qu'on a bâti sur les remparts médiévaux et à leurs pieds sur les ruines des bastions et des demi-lunes tout un quartier de "maisons de ville" en rejetant les espaces verts au delà. C'est exactement le contraire qu'on aurait pu faire : espaces verts aux pieds des remparts, sur les bastions et les demi-lunes, voies de circulation et lotissements plus loin !
(6) Il faut noter que l'amorce du développement de ce quartier ouest aurait pu commencer bien avant l'arrivée du chemin de fer si le projet de contournement de la place forte, initié en 1750, avait été rapidement réalisé. Il n'arrivera à son terme qu'au milieu du XIXe s. par la construction du pont rouge sur la Basse. Ainsi, en "1860, les portes et les fortifications n'étaient plus un obstacle à la circulation des marchandises et des personnes" vers l'Espagne. (ADRa). Le déclassement aurait suffi à donner encore plus de dynamisme à l'urbanisation de ce quartier. La démolition quant à elle n'a rien ajouté de positif.
(7) Dès 1176, le roi d'Aragon Alphonse II tout en confirmant les nombreux privilèges que les comtes du Roussillon avaient accordés aux Perpignanais, "veut et ordonne" que les habitants participent par un impôt à l'entretien des murailles de la ville.
(8) Encore aujourd'hui on peut lire sur Internet à propos de Perpignan : "...les remparts encerclaient et étouffaient la ville. Ils ont été détruits durant le premier tiers du XXe siècle. Ainsi la ville a pu s'étendre...", relation de cause à effet que je conteste absolument.